L’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) est souvent présentée comme un dispositif hérité de la psychanalyse. Ce postulat, largement admis, est pourtant questionnable. Et s’il s’agissait d’un biais historique et conceptuel ?

Pourquoi réduire les dispositifs d’APP à une filiation psychanalytique, alors qu’il serait tout aussi juste de défendre qu’ils sont ancrés, avant tout, dans des courants philosophiques ?
Cet article propose de raconter autrement l’Histoire des Analyses de Pratiques et suggère une ouverture sur un terreau de naissance bien plus ancien : celui de la philosophie.
Les groupes Balint s’appuient effectivement sur une approche psychanalytique, notamment sur des concepts issus de la psychanalyse de S.Freud et M. Klein. Ils cherchent à analyser la relation soignant-soigné. L’accent y est mis sur l’inconscient dans la pratique professionnelle et les dynamiques transférentielles entre médecins et patients. Cependant, regarder les Analyses de Pratiques Professionnelles sous cet angle exclusivement psychanalytique est réducteur : d’autres influences majeures les caractérisent.
A l’université, durant mes études de psychologue, j’ai rencontré un psychologue clinicien dont j’ai apprécié le pragmatisme : G.Rouan. C’est lui qui m’a enseigné la maïeutique socratique,et aussi l’herméneutique. Aussi, il m’a initié à la phénoménologie. Et si je les cite tous les trois aujourd’hui, c’est qu’ils permettent, je trouve, de saisir l’essence même de la démarche d’Analyse des Pratiques.
Socrate et la maïeutique : faire accoucher la pensée

Bien avant Freud, Socrate posait déjà les bases d’une démarche réflexive avec la maïeutique. En posant certaines questions (le questionnement socratique), il amenait son interlocuteur à douter et à déconstruire ses certitudes.
Son approche visait à permettre l’ accouchement d’une pensée propre pour ainsi affiner dans la compréhension du réel. Dans les groupes d’Analyse de la Pratique, cette posture socratique se retrouve : le rôle de l’animateur est d’accompagner la réflexion du groupe, en le questionnant et non d’interpréter les paroles des participants à la manière d’un analyste.
L’herméneutique : comprendre avant d’interpréter
Paul Ricœur nous dit “comprendre, c’est avant tout suspendre son jugement pour écouter l’autre”. Assise sur les bancs de la fac, j’avais eu un véritable intérêt pour cette définition. Encore aujourd’hui, je la trouve pertinente, fine, humble (et même poétique).
L’herméneutique, joue, selon moi, un rôle fondamental dans les dispositifs d’Analyse des Pratiques parce qu’elle met l’accent sur le sens que donnent les professionnels à leurs expériences. Dans les groupes d’Analyse de la Pratique, ce postulat herméneutique se retrouve : le rôle de l’animateur est d’accompagner les participants à discerner comment leurs interprétations sont influencées par leur subjectivité, culture, habitudes…
La phénoménologie : revenir à l’expérience vécue
Un autre courant philosophique essentiel aux dispositifs d’Analyse de la Pratique me semble t-il, est la phénoménologie (E.Husserl, M.Merleau-Ponty). Dans la phénoménologie l’accent est mis sur la perception et l’expérience subjective. Tous deux, considérés comme le point de départ de toute compréhension. Dans les Analyses de Pratiques, on retrouve cette dimension phénoménologique dans l’attention portée à ce qui est vécu et exprimé par les participants, sans chercher à y faire correspondre une interprétation. La phénoménologie permet de fait, je trouve, une approche ancrée dans le réel, en valorisant les ressentis et la manière propre de chaque participant à donner du sens à ses actions.
Sortir du mythe psychanalytique : une nécessité pour l’APP
Continuer à présenter l’Analyse des Pratiques Professionnelles comme un simple prolongement de la psychanalyse pourrait être qualifié d’ erreur historique et méthodologique. Certes, certains dispositifs comme les groupes Balint s’inscrivent dans cette lignée, mais ils ne représentent qu’une partie des Analyses de Pratiques.

Persister dans une lecture psychanalytique unique de l’APP revient à nier sa véritable richesse. Il est temps de reconnaître l’ampleur de son héritage, de valoriser ses fondements philosophiques et d’en assumer la pluralité.
Anne CHIMCHIRIAN – Intervenante & Formatrice en APP – Mars 2025


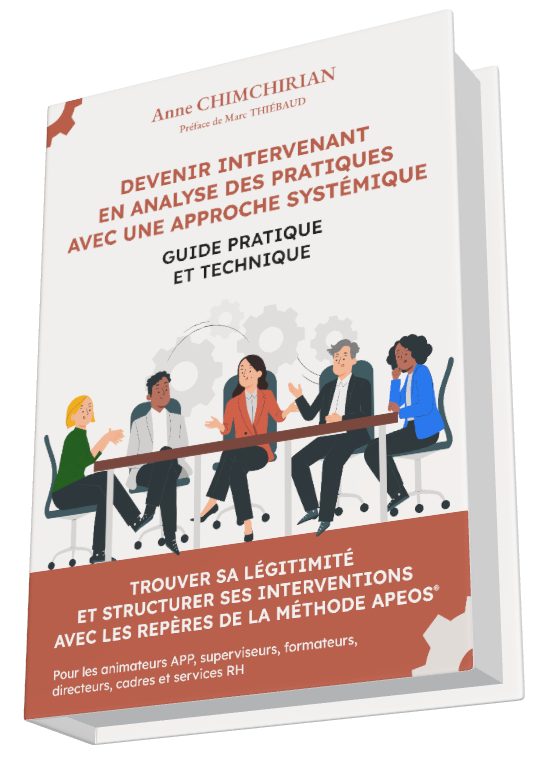


 Publications
Publications

Commentaires